Psychothérapie institutionnelle
La Borde : une utopie psychiatrique depuis 1953
La Borde est un établissement psychiatrique fondé par le docteur Jean Oury en 1953, dans le Loir-et-Cher. Son ambition était alors d’humaniser le fonctionnement des établissements psychiatriques. Cette utopie psychiatrique, toujours en mouvement, continue de fonctionner par le principe de la remise en cause permanente. Henri Cachia nous propose une plongée dans l’atmosphère de ce lieu unique d’expérimentation qui a permis le développement de la psychothérapie institutionnelle.
mardi 1er août 2017 (Henri Cachia)

En arrivant dans cet hôpital, disons plutôt un asile au sens noble du terme, l’absence des blouses blanches, si présentes d’ordinaire dans ces lieux de rétention, pose question d’emblée. Loin d’être un détail, c’est plutôt perturbant pour les nouveaux arrivants, qu’ils soient pensionnaires, stagiaires, médecins ou simples visiteurs. Et même si on le sait, le vivre change sacrément le point de vue. Qui est qui ? En effet, chacun porte ses vêtements de ville et circule librement à l’intérieur de cette clinique psychiatrique pas comme les autres, vaste propriété qu’aucun mur ne ceinture, ce qui de fait facilite les relations avec le monde extérieur. Alors qui est qui ? On ne peut que s’interroger sur la ligne ténue entre normalité et anormalité. On peut très bien échanger avec l’un en le prenant pour un soignant, ou avec l’autre en le prenant pour un soigné, alors qu’il s’agit du contraire. A La Borde on n’a affaire qu’à des
êtres humains.
Exemple : j’étais arrivé depuis une semaine, lisant sur mon lit, la porte de ma chambre grande ouverte, lorsqu’une voix grave et forte interpella quelqu’un ou quelqu’une à l’autre bout du couloir. Le voyant passer, je me dis « tiens, un nouveau pensionnaire ». Pas du tout. C’était tout simplement un psychanalyste rentrant de
congé.
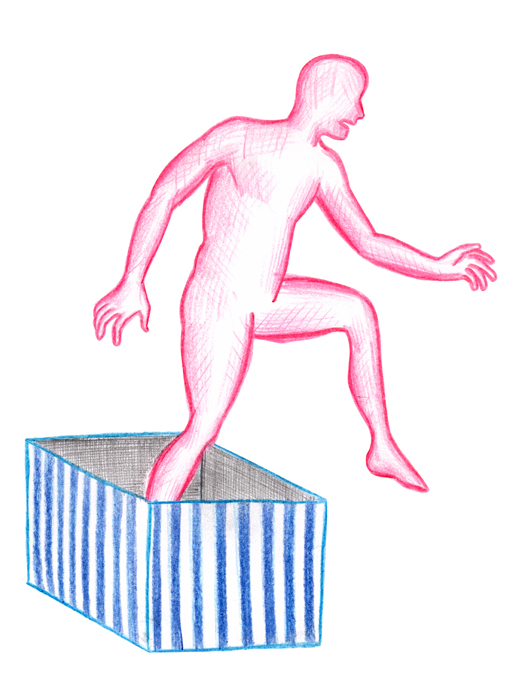
- Escape / Illustration Vincent Couturier
Saint-Alban : les racines
François Tosquelles (psychiatre marxiste catalan), condamné à mort par le régime de Franco, obligé de fuir sa Catalogne, accepta fin 1939 un poste à l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban, isolé, perdu en Lozère. Très vite, la préoccupation première se révéla être l’alimentation. Nourrir une population de mille personnes en ces temps-là n’était pas une mince affaire. Tosquelles, rejoint peu après par Lucien Bonnafé à la tête de cet établissement, proposa aux pensionnaires volontaires de remplacer les hommes (partis à la guerre) dans les fermes alentour afin de cultiver les champs et s’occuper des animaux. Non seulement cela changea le regard des habitants de ce village sur la folie, mais toute la population saint-albanaise put s’alimenter, au moins pour ne pas mourir de faim. Sous l’Occupation, 40 000 malades mentaux périrent en France, le gouvernement de Vichy ne ravitaillant plus les hôpitaux psychiatriques. Pas de mort de faim à Saint-Alban.
Beaucoup de résistants antinazis furent accueillis et vécurent dans cet asile, côtoyant des artistes comme Paul Eluard, Tristan Tzara, Denise Glaser, mais aussi Auguste Forestier. On peut voir aujourd’hui ses sculptures au LAM (Musée d’Art moderne, d’Art contemporain et d’Art brut de Villeneuve-d’Ascq Lille Métropole) et à La Collection d’Art brut de Lausanne.
Peu importait qui était qui. Il fallait s’organiser pour que tout le monde mange. Se serrer les coudes. Et ça marchait ! Inutile de souligner que les relations à l’intérieur de l’hôpital, et à l’extérieur furent radicalement changées.

- Portrait de pensionnaire / René Caussanel
Le retour des infirmiers
« Des infirmiers, pendant la guerre, avaient été prisonniers ; certains avaient été dans des camps de concentration... Quand ils sont rentrés, ils avaient une vision du monde différente : leur milieu de travail, le même qu’avant-guerre, leur rappelait l’expérience qu’ils venaient de traverser.
C’est un événement, dans la vie de quelqu’un, de reprendre sa profession d’avant-guerre, et de constater à peu près la même atmosphère dans son travail que dans
les camps de concentration !… Nous pourrions donc définir la psychothérapie institutionnelle, là où elle se développe, comme un ensemble de méthodes destinées à résister à tout ce qui est concentrationnaire. “Concentrationnaire”, c’est peut-être un mot déjà vieilli – on parle actuellement de “ségrégation”... » [1].
Ces infirmiers ont grandement contribué à la réflexion des médecins psychiatres de Saint-Alban, désireux de modifier la structure de leur hôpital. La légende dit que François Tosquelles a traversé la frontière avec la thèse de Lacan et les écrits d’Hermann Simon (« Pour soigner les quartiers d’agités, il faut soigner
l’ambiance »).
Résistants, fous, thérapeutes, intellectuels se mirent à rêver à un avenir meilleur qui permettrait de modifier les relations entre soignés et soignants. Georges Daumézon nomma cette pratique : psychothérapie institutionnelle.
Jean Oury arrive à Saint-Alban le 3 septembre 1947, en qualité d’interne. Il n’y avait déjà plus de quartier d’agités. Mais davantage d’espaces de vie où tout le monde pouvait circuler librement. Aucune cellule.

- Procession / Illustration Vincent Couturier
Jean Oury
Jean Oury arrive à Saint-Alban en 1947, alors âgé de 23 ans, pour son internat qu’il effectue aux côtés de François Tosquelles (« La psychothérapie institutionnelle repose sur deux jambes : l’une freudienne, l’autre marxiste ») .
A 25 ans, il est nommé médecin-directeur de l’hôpital psychiatrique de Saumery, qu’il quittera quelques années plus tard, après un désaccord profond avec l’administration. Jugeant son successeur tout à fait incompétent, et après en avoir averti le Conseil de l’Ordre des médecins, il part avec ses patients et son équipe en recherche d’un lieu où il pourra exercer son travail de psychiatre dans des conditions décentes. Le 3 avril 1953, après trois semaines où ils logeront dans des couvents, des petits hôtels, et des abris de fortune, Jean Oury trouvera enfin un château mal en point qui s’avérera faire l’affaire pour longtemps. Il était alors urgent de s’y mettre et tout le monde retroussa ses manches pour retaper le château de La Borde, grâce à un prêt bancaire. Jean Oury a alors 29 ans.
Dès 1955, il est rejoint par son ami d’enfance de la banlieue parisienne, Félix Guattari, philosophe et psychanalyste atypique (« Tout problème individuel est lié à l’ensemble du champ social qui est mis en question »), qui s’engagera à fond dans cette aventure.
Jusqu’au 16 mai 2014, date de son décès, Jean Oury ne cessera d’évoquer lors de ses séminaires labordiens hebdomadaires (entre autres) toutes les étapes, les avancées importantes de la psychothérapie institutionnelle, et ceux qui, à différents niveaux avec lui, l’ont fait vivre et se développer : Lucien Bonnafé (« On juge du degré de civilisation d’une société à la manière dont elle traite ses fous »), Gilles Deleuze (« C’est toujours par autrui que passe mon désir, et que mon désir reçoit un objet. Je ne désire rien qui ne soit vu, pensé, possédé par un autrui possible »), Fernand Deligny
(« T’interdire de punir t’obligera à les occuper »), et bien sûr Jacques Lacan (« Le discours du psychotique a un sens »), avec qui il a fait une analyse de plus de vingt années. Cette relation ira bien au-delà de cette analyse. De très nombreux intellectuels, artistes, stagiaires du monde entier sont venus et continuent de venir à La Borde, pour réfléchir et remettre en question de façon permanente cette pratique qui ne cesse de se renouveler depuis 1953.
Jean Oury, et son équipe qui s’étend au-delà de l’aire labordienne, ont su depuis plus de six décennies faire en sorte qu’elle continue d’avancer avec la même dynamique et l’envie de toujours changer pour rester vivant(e).
A ceux qui se demandent ce qu’est devenue La Borde après Jean Oury, on ne peut que les inciter à aller voir... Ça continue bel et bien. Yannick Oury-Pulliero, au milieu de la même grande équipe, poursuit le travail entrepris par le père fondateur. Elle dit « ...Un des aspects qui caractérise la clinique de La Borde, c’est l’importance donnée à la vie quotidienne. Ce qui s’y passe ne peut pas se déchiffrer sans y avoir séjourné un certain temps, que ce soit comme patient ou comme soignant. »

- Portrait de pensionnaire / René Caussanel
Les réunions
À La Borde, les réunions c’est le pain quotidien. Chaque problème non résolu donne naissance à une commission composée de soignés et soignants. Tant qu’une solution satisfaisante n’est pas trouvée, on discute, on échange ; il y a forcément des désaccords, qui peuvent parfois déboucher sur certains énervements, des conflits. Les conflits ne font-ils pas partie intégrante de la vie ? Bien exploités, ils peuvent donner lieu à une créativité salvatrice. Selon la complexité des différents problèmes à traiter, une seule réunion peut suffire, d’autres en nécessitent de nombreuses. Il ne s’agit pas de bâcler. Toute décision importante et nouvelle sera retranscrite dans le journal de la clinique Les Nouvelles labordiennes.

- Vaisselle / Illustration Vincent Couturier
Les journal : Les nouvelles labordiennes
Si je ne connais pas la date de naissance exacte du journal, je suppose qu’il est né à l’occasion d’une des nombreuses réunions dont cet hôpital est très friand. La population labordienne ne cessant de croître au fil des ans, certains se plaignant d’être insuffisamment informés d’événements jugés importants à leurs yeux, l’idée d’un journal dut être émise, et après discussions, Les Nouvelles labordiennes virent le jour. En tout cas, c’est comme ça que je me l’explique.
Il est vrai qu’aujourd’hui, la propriété du château de La Borde s’étend sur 19 hectares, et sa population globale de près de trois cents habitants en fait un véritable petit village, avec ses différents secteurs et nombreux lieux aux fonctions spécifiques. On peut ne pas croiser certaines personnes durant plusieurs jours, ou tout simplement ne pas échanger avec l’un ou l’autre parce que nos centres d’intérêt divergent.
La Borde n’est pas un paradis. C’est une microsociété où l’on peut se côtoyer sans forcément s’apprécier. Pourtant ce qui fait la force de ce lieu, c’est le respect mutuel et naturel. Cette mentalité s’est incrustée année après année, déposant une succession de strates, rappelant à chacun un point commun : la souffrance.
Le journal Les Nouvelles labordiennes a son fonctionnement propre, et comme dans n’importe quelle autre rédaction, seuls ses collaborateurs le connaissent. Tout le monde peut y proposer un article sur le sujet de son choix, mais n’est pas forcément publié. Deux de mes propositions furent refusées, avant qu’une troisième paraisse dans cet hebdomadaire. L’équipe de rédaction, tournante, accepte tous les coups de main de bonne volonté, notamment les nombreux textes manuscrits à taper, avant de les remettre au graphiste de service pour la mise en page avant impression.
Ce qui s’est passé, se passe ou se passera non seulement à La Borde, mais également en lien avec l’extérieur, est relaté dans ce journal. S’il s’adresse principalement à la population labordienne, il est proposé en abonnement, également en direction des autres hôpitaux psychiatriques et des nombreuses familles.
Voici ce que j’ai pu lire (entre autres), de la plume de Th. dans un numéro de cet hebdomadaire : « Ne m’enlevez pas mon groupe journal... Ecrire, ça sauve. Quand on est (ou était) pas bien, un seul recours : l’Ecriture. J’avoue que j’ai du mal à faire un écrit cohérent, mais je vais essayer. Je disais donc que c’est en écrivant qu’on se retrouve. C’est pour cela, comme je dis dans le titre, qu’il ne faut pas que le groupe journal n’existe pas. Cela me fait tellement de bien. On est là avec les copains et les copines, dans un silence ponctué de petits dialogues et on écrit avec courage et construction. Oui, car il faut un peu de courage pour écrire. Et aussi on se construit, au sens propre comme au figuré. Au sens propre parce qu’on s’y sent bien en écrivant et au sens figuré car on écrit quelque chose de l’écrit en soi. Aujourd’hui, mercredi, j’ai eu des bouffées délirantes ce matin, j’ai fait une sieste d’une heure et j’ai pris mes médicaments. C’est pour cela, avec l’écriture, que je me suis relevé. Maintenant, je me sens bien et, même si c’est invraisemblable (que le journal n’existe plus), je crie pour préserver mon petit bonheur. À tous les écrivains. Amitié. »
[1] Jean Oury, La Psychothérapie institutionnelle de Saint-Alban à La Borde, Editions d’une




 Roter Stern : à Leipzig, les migrants ont leur équipe
Roter Stern : à Leipzig, les migrants ont leur équipe
 Venise n’est pas encore sortie de l’auberge
Venise n’est pas encore sortie de l’auberge
 Franck Lepage : « Les conférences gesticulées, une psychothérapie politique »
Franck Lepage : « Les conférences gesticulées, une psychothérapie politique »
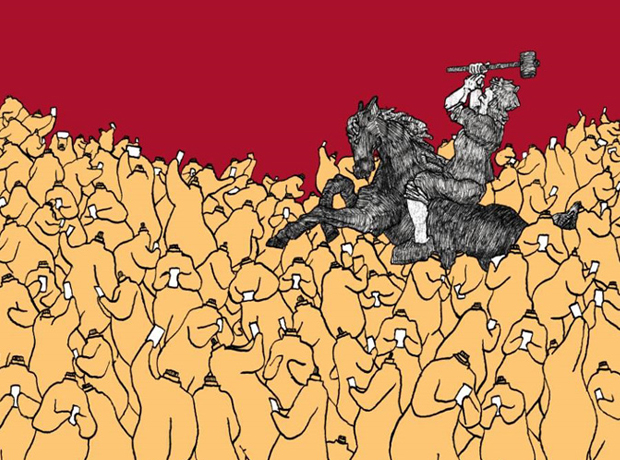 « On essaie de saboter la machine de l’acceptabilité »
« On essaie de saboter la machine de l’acceptabilité »